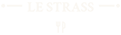Mais Pourquoi Diable les Français Mangent-ils de la Galette ? Percer le Mystère Pâtissier!
Ah, la galette des rois! Ce mystère feuilleté, fourré de frangipane (ou autre délice, soyons ouverts d’esprit!), qui débarque chaque début d’année dans nos vies. Mais au fond, pourquoi donc les Français se ruent-ils sur cette pâtisserie après les excès des fêtes? Est-ce une conspiration des boulangers pour nous faire replonger dans le sucre dès janvier? Ou une tradition ancestrale avec une histoire plus croustillante que la galette elle-même? Accrochez-vous, on part à la découverte des raisons cachées (ou pas si cachées) derrière cette gourmandise nationale. La réponse courte, et on aime aller droit au but, c’est que les Français mangent de la galette des rois pour célébrer l’Épiphanie. Oui, l’Épiphanie, cette fête religieuse qui sonne un peu comme un mot de Scrabble imprononçable. Mais qu’est-ce que c’est que l’Épiphanie au juste? Et quel rapport avec cette fameuse galette ? L’Épiphanie, mes amis, c’est le 6 janvier. C’est le jour où, selon la tradition chrétienne, les Rois Mages, ces fameux Melchior, Gaspard et Balthazar, sont arrivés à Bethléem pour rendre visite à l’enfant Jésus. Imaginez un peu le voyage! De l’Orient jusqu’à la Judée, avec des cadeaux un peu plus originaux que des chaussettes de Noël : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. On est loin du bon d’achat chez Amazon, n’est-ce pas ? Alors, quel est le lien avec la galette? Et bien, au fil des siècles, cette arrivée des Rois Mages est devenue une occasion de festivité. Et comme les Français sont experts en matière de festivité et encore plus en matière de pâtisserie, ils ont inventé la galette des rois. C’est logique, non ? On célèbre l’arrivée de rois, alors on mange un gâteau de rois ! Simple, efficace, et surtout délicieux. Mais attention, la galette des rois, ce n’est pas juste un gâteau. C’est une institution, un rituel, un moment de convivialité. Et au cœur de ce rituel, il y a la fameuse fève. La fève, cette petite figurine cachée dans la galette, qui transforme chaque part en une potentielle source de joie (ou de légère déception si on tombe sur la part sans fève, avouons-le). Trouver la fève, c’est un peu comme gagner à la loterie (version miniature et comestible). Celui ou celle qui la découvre devient roi ou reine d’un jour. Et avec le titre, vient la couronne en carton doré (parce qu’on ne va pas sortir la couronne en or massif pour une galette, faut pas exagérer non plus!). On choisit sa reine ou son roi (si on a trouvé la fève quand on est déjà roi ou reine, c’est un peu la promotion interne, non ?) et on trinque (avec du cidre, du jus de pomme, ou du champagne si on a vraiment envie de faire les choses en grand!). Cette tradition de la fève remonte loin, très loin. À l’époque des Romains déjà, on utilisait une fève blanche ou noire pour tirer au sort le roi ou la reine des Saturnales, des fêtes païennes qui se déroulaient en hiver. Comme quoi, l’idée de désigner un chef de fête en cachant un petit objet dans un gâteau, c’est une idée qui a traversé les âges. Les Romains avaient du goût, il faut le reconnaître. Et puis, au fil du temps, la galette des rois a évolué. Au début, c’était une simple galette de pain. Puis, on a commencé à la faire à la frangipane, cette crème d’amandes gourmande à souhait. Mais aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts! Galette au chocolat, aux pommes, aux framboises, pistache… Les pâtissiers rivalisent d’imagination pour nous surprendre et nous faire saliver. On ne va pas s’en plaindre, hein ? Alors, pourquoi les Français mangent-ils de la galette ? Par tradition, bien sûr. Pour célébrer l’Épiphanie, pour honorer les Rois Mages, pour le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis, pour le suspense de la fève, pour la joie de devenir roi ou reine (même si ce n’est que pour quelques heures), et surtout, surtout, parce que c’est bon ! Avouez-le, vous aussi, vous avez envie d’une part de galette maintenant, non ? Et si vous trouvez la fève, n’oubliez pas de penser à nous quand vous serez sur votre trône (en carton, mais trône quand même!).